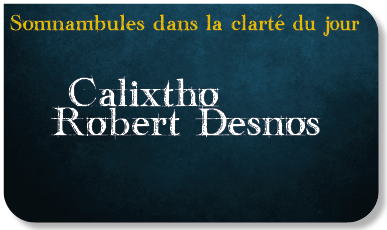in "I -Somnambule dans la clarté du jour"
Je travaillais dans un musée aussi splendide que singulier. Il conservait les principaux trésors de l’invention humaine. Du premier avion aux ponts monumentaux reliant les territoires, et du télégraphe à l’imprimerie en passant par le cinématographe, les grands espoirs humains s’y trouvaient révélés et comblés. Dans ce temple de l’imagination prométhéenne, le visiteur n’aurait jamais pu se douter qu’une direction imbécile donnait le contrepoint à tant d’intelligence en un seul lieu. Deux handicapés de la générosité poursuivaient, par leurs choix médiocres, la dernière œuvre inachevée de Gustave Flaubert. Là où tant de lumières brillaient encore par-delà les siècles dans chaque recoin du musée, eux s’illustraient chaque jour avec obstination par leur absence totale de clairvoyance. Vieil homme et vieille femme, ils formaient un couple stérile et destructeur. Leurs cœurs secs dévoilaient encore et toujours un éventail de viles attitudes fondées sur l’atteinte d’honneurs misérables – cette recherche factice de reconnaissance, désir des grands titres, que partagent toujours ceux qui ne les méritent pas. À la fois rivaux et complices, ils asphyxiaient inexorablement toute velléité de faire vivre avec passion ce lieu. Je me sentais condamné à l’exil, opposant malgré moi, sans pouvoir servir cet espace que j’aimais tant et qui allait me le rendre au centuple en m’indiquant le moyen de dépeindre ma métropole onirique.
Après avoir vécu la pantomime journalière de l’idiotie et les figures imposées par ces deux grandeurs relatives, je remontais chaque soir le fleuve de l’invention, en traversant les salles vides du musée fermé. Cette odyssée replaçait immédiatement le sens en face du signe. Chaque pièce immense, au plafond très élevé, amplifiait le grincement du parquet ancien et chaque pas était comme le balancier d’une horloge rappelant ma plongée dans le temps. De mon bureau à la sortie du personnel, et de machine en machine, plusieurs itinéraires étaient possibles, mais je privilégiais souvent le parcours dédié à l’épopée de la mémoire, où se trouvaient des trésors d’ingéniosité pour apprivoiser le son, reproduire l’image, transposer les paroles en messages au bout du monde, et prendre la lettre au mot pour l’imprimer. Les noms se succédaient comme un inventaire merveilleux : la lanterne magique, le fantascope, le zootrope, le praxinoscope et le zoogycoscope, le phonographe. Ici, la technique brillait mais ce lustre n’était que conséquence, résidu d’une poésie initiale désirant s’emparer des instants éphémères pour tracer de nouvelles façons de vivre. Le songe est le sang des machines, il circule et abreuve la matière pour lui donner sa fonction. Sans lui, la technique n’est que maîtrise morte, poids lourd d’une arme dépassée, bronze inerte d’une sculpture sans forme, dévorée par l’oxyde. Le sang des machines est le songe et pour qu’elles subsistent, utiles, intelligentes et influentes, aucune hémorragie n’est supportable.
Au milieu de l’été, sous le soleil déclinant, j’aimais m’asseoir un instant sur un large fauteuil de cuir noir permettant de contempler l’enfilade des salles sur plus de trois cents mètres. Je profitais de ma solitude en compagnie des vestiges du temps pour réfléchir à mon poème en forge et lui trouver une introduction bien inspirée. Comment réussir un glissement subtil dans cette métropole en état de songes ? Encore et encore, mon sujet résistait et je ne trouvais pas de voie séduisante pour ce passage. Transporté par la lumière douce et orangée du début de soirée, mon attention finissait toujours par se reporter sur les machines avant de conclure inlassablement qu’il manquait ici une œuvre majeure, un dispositif que l’humanité n’avait pas souhaité construire à moins que toutes ne fussent concernées. L’onirographe. On avait imaginé le moyen de communiquer ses pensées, sa voix, son regard, ses mots à distance ; on avait trouvé la façon de voir ses os rompus et ses organes en souffrance et même d’enregistrer les manifestations ondulatoires de nos cervelles Mais on avait pris soin de laisser tranquille ses rêves. Tout se passait comme s’ils ne pouvaient être à la fois le sang et la machine pour rester comme spectres ou féeries au fond des ombres de chacun.
C’est aux premières neiges que me vint l’idée, dans le musée glacé, passant et repassant devant l’émouvante chambre de Louis Daguerre dont j’admirais le procédé. Cette fois la vitrine ancienne ne me parut pas être réceptacle d’un lointain passé, celui d’un vieux mécanisme mis à distance par le manque d’usage. Au contraire, j’entrais dans le rêve porté par cet objet, qui s’imposa à moi comme le reflet impose le miroir.
Tout se passa comme si je devinais une pensée plus secrète de Daguerre : « Regardez mon appareil, il est votre métaphore. Vous êtes le bois, vous êtes le cuivre, l’iode et le mercure, vous êtes la perception de la lumière et vous êtes la chimie humaine, charnel révélateur. Depuis trop longtemps sa seule fonction vous obsède. Qu’importe la vérité que capture un tel système, seules la construction d’une apparition et la célébration d’une vision stable y triomphent pour réaliser l’état des choses insaisissables. Regardez mon appareil, créé à votre image. Camera obscura. »
Me percevoir comme cet espace clos en lequel la lumière venait se révéler sur un fond d’ombre, me laissant libre d’inventer ma perspective ? Combien de fois, par mes nuits et par mes jours, avais-je aperçu ces fines lueurs reconstituant sur ma surface sensible ce que pourraient être le monde ?
Somnambule dans la clarté du jour, je compris que je ne pourrai jamais entrer dans cette métropole en état de songes. Nous y étions déjà ! tous ! mais encore fallait-il le pressentir réellement. Seules conditions pour parvenir à mes fins : être cette chambre noire, voir clair en moi, retrouver les traces de ces femmes et de ces hommes que j’avais vu rêver, qu’ils soient endormis ou éveillés, et qui persistaient comme des images fragiles en ma mémoire. Ressentir leurs spectres subsistant en moi et en développer la fresque. Sur ma surface sensible et mes profondeurs discrètes, je trouverai les éléments d’un poème en lumière. J’étais l’onirographe, l’intuition en chambre noire, et quel autre moyen pourrait-il mieux me permettre d’accéder aux rêves des autres que je portais en moi comme des formes captieuses et obreptices ?
Planté devant la vitrine de Daguerre, j’imaginais que nous étions des milliers dans la ville, véritables appareils tissant la dentelle du réel avec le fil du songe. Comme sur la plaque de cuivre fixée sur cette machine, on aurait pu graver sur nos fronts une inscription : « Nul n’entre ici, s’il n’est en état de songes ». Et de fait, sous mon regard désormais tous le seraient.
Le diaphragme s’ouvrit. Le sentiment d’une lumière chaude envahissant la chambre obscure après un long sommeil m’envahit et effaça toutes mes incertitudes. Ce fut un éblouissement.
|
MS - Alors cette lecture est en pr� |
|
© Marc Sayous